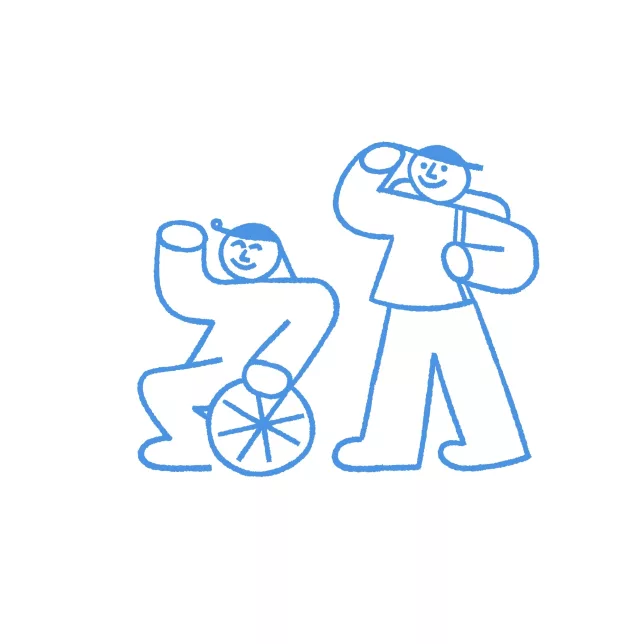IV. Comment favoriser l’autodétermination au quotidien ?
4.1 Penser autrement l’accompagnement
Favoriser l’autodétermination ne consiste pas à ajouter une case de plus au projet personnalisé. C’est une transformation profonde du rapport à l’accompagnement. Cela commence par une question posée différemment : non plus “qu’est-ce qu’on peut faire pour elle ou lui ?”, mais “comment puis-je créer les conditions pour qu’elle ou il puisse choisir ?”.
Ce déplacement demande un effort de désapprentissage : ne plus anticiper à la place, ne plus présumer des désirs ou des capacités, ne plus réduire les choix à ce qui est simple à organiser. Il ne s’agit pas de retirer tout cadre — mais de faire une place réelle à la subjectivité, à l’inattendu, au “je ne sais pas encore”.
4.2 Construire des occasions de choix réels
Au quotidien, les opportunités d’agir selon ses envies sont nombreuses. Mais encore faut-il qu’elles soient :
- réelles (avec au moins deux options distinctes)
- accessibles (présentées avec des supports compréhensibles)
- valorisées (considérées comme importantes, quelle qu’en soit la portée)
Un petit déjeuner, une tenue vestimentaire, un moment de repos, une activité proposée… autant de moments ordinaires qui peuvent devenir, s’ils sont pensés autrement, des supports d’émancipation. Le risque est grand, dans les institutions, de standardiser les habitudes, de faciliter la logistique, de réduire l’individualisation à une série de variables fixes. Or, une personne ne cesse pas de changer, d’évoluer, de reformuler ses préférences.
“Choisir, c’est aussi dire ‘aujourd’hui je ne veux pas ce que je voulais hier’. Laisser ce droit, c’est reconnaître l’autre comme vivant.”
4.3 Soutenir sans diriger : le rôle de l’accompagnement
Le rôle du professionnel est fondamental. Il ne s’agit pas de se retirer, mais d’accompagner sans imposer, de soutenir l’expression sans la façonner. Cela implique de poser des questions ouvertes, de proposer des alternatives compréhensibles, et surtout, de savoir écouter ce qui ne se dit pas immédiatement.
Cela signifie aussi de :
- rassurer sans infantiliser
- laisser le droit à l’hésitation
- valoriser la prise de décision, même lorsqu’elle semble minime
Certaines personnes, après des années d’accompagnement normé, ont besoin de temps pour “réapprendre à vouloir”. Le choix n’est pas une évidence, c’est une capacité qui se cultive, comme une langue étrangère trop longtemps oubliée.
4.4 Créer des environnements qui soutiennent le pouvoir d’agir
L’environnement joue un rôle déterminant. Il peut contraindre ou, au contraire, libérer. C’est pourquoi l’autodétermination ne peut être réduite à une compétence individuelle. Elle est relationnelle, contextuelle et collective.
Pour cela, plusieurs leviers concrets peuvent être mobilisés :
- Des supports visuels (photos, pictogrammes, vidéos explicatives),
- Le recours au Facile à Lire et à Comprendre (FALC) pour l’ensemble des documents de la vie quotidienne,
- L’adaptation des temps de réunion, avec des préparations individualisées en amont,
- La mise en place de pairs-aidants ou d’ambassadeurs, qui inspirent par l’exemple et favorisent une parole libre entre personnes concernées,
- L’organisation d’espaces de parole, où l’objectif n’est pas de “valider un choix”, mais d’explorer des envies, des doutes, des ressentis.
Ces ajustements ne nécessitent pas toujours de grands moyens, mais une volonté collective de rendre les environnements plus sensibles aux personnes.